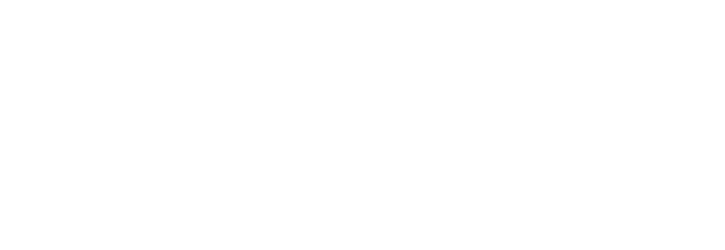Cet échange de lettres entre Divine, de Bukavu, et Tessi, de Bruxelles, explore les réalités et défis liés à la paix, à la justice et aux institutions solides, en lien avec l’Objectif de Développement Durable 16. Elles partagent leurs expériences de conflits, discriminations et identités, tout en réfléchissant aux actions possibles pour un changement positif.
Lettre 1
Bukavu, le 13 mai 2025
Objet : Vivre la paix et la justice : réalités et défis dans nos sociétés
Très chère Tessi, bonjour,
J’espère que cette lettre te trouve en bonne santé et de bonne humeur, ainsi que toute ta famille. C’est Divine, ton penfriend depuis Bukavu. Je suis vraiment heureuse d’avoir été jumelée avec toi pour ce projet, et j’ai hâte d’échanger avec toi sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Je suis convaincue que nos discussions seront enrichissantes et nous aideront à mieux comprendre comment contribuer, chacune à notre manière, à bâtir une société fondée sur la paix, la justice et des institutions solides dans nos environnements respectifs.
Dans un monde idéal, chacun devrait pouvoir vivre en sécurité, sans crainte de violences ni discriminations liées à son origine ou sa religion. Mais ici, en RDC, la réalité est tout autre. L’injustice est omniprésente, et l’accès à une justice équitable reste un luxe réservé à une minorité influente. La corruption gangrène tous les secteurs de la société et c’est souvent ceux qui disposent des moyens financiers ou de connexions puissantes avec les autorités qui obtiennent toujours gain de cause, loin du principe du « premier arrivé, premier servi ».
Dans mon environnement, le mérite et l’équité sont souvent relégués au second plan. Le tribalisme et le népotisme influencent énormément les décisions, que ce soit dans l’octroi des opportunités professionnelles ou dans la gestion des affaires publiques. Trop souvent, ce ne sont pas les compétences qui déterminent l’accès à un poste particulier, mais plutôt le niveau d’affinité avec un membre du personnel de ladite société, voire l’appartenance à un même groupe ethnique, religieux ou à une même communauté.
Une autre réalité alarmante est l’exploitation humaine, notamment dans les mines artisanales où des milliers de travailleurs, y compris des enfants, sont sous-payés et contraints à des conditions de travail inhumaines. Ils peinent à gagner, ne serait-ce qu’un dollar par jour, pendant que les véritables bénéficiaires de ces ressources s’enrichissent dans des bureaux climatisés, bien loin de la poussière et de la fatigue des mines.
L’insécurité est une autre facette de ce problème. Je vis actuellement à Bukavu, une ville située à l’est du pays. C’est une région stratégique et immensément riche en ressources minières comme le coltan, le cobalt, l’or et tant d’autres. Malheureusement, cette richesse attise les convoitises et alimente de nombreux conflits armés. Depuis des décennies, l’est de la RDC est en proie à une instabilité chronique, où différentes parties s’affrontent pour le contrôle du territoire et de ses ressources. Depuis plus de 30 ans, la présence de groupes armés a fait des milliers de morts, des milliers de femmes victimes de violences sexuelles et des millions de déplacés forcés d’abandonner leurs maisons. Le mois dernier, la situation a empiré avec l’intensification des combats entre les forces locales et étrangères, paralysant complètement la vie économique et sociale du Sud-Kivu en général et de Bukavu en particulier.
De ce fait, beaucoup d’activités ont cessé, et nos parents ne peuvent plus travailler normalement. Les banques ont fermé, provoquant une crise de liquidité et une instabilité du taux de change. Des entrepôts et des institutions stratégiques ont été pillés, comme la BRALIMA et le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Les routes d’approvisionnement en denrées alimentaires sont bloquées, et les échanges commerciaux avec les pays voisins, comme le Burundi, sont à l’arrêt. L’agriculture et l’élevage, pourtant essentiels à notre survie, sont complètement à l’arrêt dans les zones touchées par les conflits. Cette situation a profondément bouleversé l’économie de la province.
En théorie, notre système est démocratique, et nous élisons des représentants pour porter nos voix et défendre nos intérêts. Cependant, dans la pratique, il est parfois difficile pour les citoyens d’accéder à ces élus, qui peuvent être confrontés à diverses pressions et priorités. Les décisions importantes sont souvent influencées par des acteurs ayant davantage de ressources, ce qui peut limiter l’inclusivité du processus.
L’un des défis majeurs reste aussi le fossé qui s’est creusé entre l’est et l’ouest du pays. À Kinshasa, la capitale, nous, les habitants de l’est, sommes souvent appelés « Baswahili » en raison de notre langue commune, le Kiswahili. Ce qui devrait être un simple fait linguistique s’est transformé en un stigmate, et la méfiance envers nous est palpable. À tel point que certaines personnes subissent des agressions simplement parce qu’elles s’expriment en Kiswahili, alors que cette langue fait partie des quatre langues nationales reconnues en RDC. Ce manque de cohésion nationale aggrave les tensions, et nous sommes parfois perçus, à tort, comme des complices de l’ennemi. Pourtant, depuis toutes ces années et jusqu’à aujourd’hui, ni le pouvoir public, ni la société civile, ni même les communautés elles-mêmes n’ont pu trouver de solutions durables face aux conflits et à l’insécurité. Dans ces conditions, nous n’avons souvent d’autre choix que de chercher des moyens de survivre, ce qui peut nous placer dans des situations complexes et ambiguës, relevant du phénomène communément appelé « syndrome de Stockholm ».
Tessi, j’aimerais savoir comment l’accès à la paix et à une justice équitable sont vécus dans ta société. Quelle est ton opinion à ce sujet ? Quels sont les principaux défis pour promouvoir une société pacifique et inclusive dans ton environnement ?
Je pourrais continuer encore longtemps sur ce sujet, mais je préfère m’arrêter ici pour cette fois. J’ai hâte de lire ta réponse et de découvrir ton point de vue. En attendant, prends bien soin de toi et transmets mes salutations à ta famille.
Avec toute mon amitié, à très vite !
Divine
Lettre 2
Bruxelles, le 25 mars 2025
Objet: L’Europe : un exemple ou une illusion
Ma très chère Divine,
Ta lettre est tellement riche en histoire, en connaissances et en émotions. Chaque mot crée un impact et me ramène à une réalité qui m’était jusque-là inconnue.
Je t’en remercie.
Et j’en suis désolée.
Laisse-moi te dire que mon expérience est très différente de la tienne, dans tous les sens du terme.
Je vis en Europe, plus précisément en Belgique, et plus précisément encore à Bruxelles.
Bruxelles a son propre monde. Un monde dans lequel je me sens en sécurité, où la diversité est la norme et est vue comme le point commun de tous.
En étudiant à Anvers, une ville avec une autre culture, une autre langue et une autre communauté, j’ai eu l’opportunité de faire des liens, d’observer les similitudes mais aussi les différences avec la capitale.
Laisse-moi m’expliquer : depuis toute petite, je me suis toujours considérée belge. Belge avec une origine marocaine. Je pensais que mon identité n’avait aucun lien avec le sang. Pourquoi en aurait-elle un ?
Et puis, j’ai appris à connaître le monde flamand : d’abord avec sa langue, ensuite à travers sa mentalité, et tout cela par l’intermédiaire des étudiants de l’université.
Et là, petit à petit, je comprenais. Je comprenais que je ne venais pas d’ici. Je comprenais que ce pays n’était pas mon identité ; sa capitale l’était.
Je ne suis pas belge et je ne le serai jamais. Je suis marocaine. Et ma religion marquera toujours ma différence avec les autres, peu importe d’où je viens.
Je ne suis donc pas chez moi, pas complètement. Bruxelles est ma ville, mon identité, mais l’islam l’est encore plus.
C’est pourquoi je voudrais vivre dans un pays musulman, car cela me donnera sûrement ce qui m’a toujours manqué : une satisfaction identitaire complète.
Ou peut-être pas… et si cette satisfaction n’était qu’un mythe, et si ce niveau de plénitude n’existait pas ?
Dans tous les cas, j’ai beaucoup de gratitude pour tout ce que Dieu m’a donné. J’ai toujours eu tout ce dont j’avais besoin, tout ce que je voulais.
Et bien sûr, le plus important : je peux être qui je veux.
Divine, je vais donc répondre à tes questions si pertinentes, qui nous ramènent au sujet de la paix et de la justice.
Tu voulais savoir comment l’accès à la paix et à une justice équitable est vécu dans ma société.
Je peux te dire que la paix est présente, et Dieu m’a toujours offert un environnement équitable.
Mais tout n’est pas rose.
Les migrants qui arrivent en masse sans être aidés, les discriminations à l’école et dans le monde du travail, les mensonges des journaux télévisés sur ce qui se passe dans le monde…
Tout cela donne l’impression que nous ne vivons que dans l’ombre de la réalité.
La réalité est au bout de nos doigts, mais nous choisissons de la filtrer, de sélectionner ce que nous voulons accepter et de mettre de côté ce que nous refusons de voir.
L’Europe vit dans sa bulle, tout comme moi qui ai toujours vécu dans mon petit monde, la bulle de la capitale.
Cette capitale est-elle pacifique et inclusive ? Oui, sans aucun doute.
Et le reste de la société ? Elle aime dire que oui. Je suis sûre qu’elle l’est, jusqu’à une certaine limite.
Elle promeut l’inclusivité, elle promeut une société meilleure.
Mais alors, pourquoi a-t-elle aidé les Ukrainiens et continue-t-elle à ignorer la situation palestinienne ?
Pourquoi accroche-t-elle des drapeaux arc-en-ciel partout, mais pas un seul pour soutenir la pauvreté au Yémen, les camps de Ouïghours, la dictature en Corée du Nord, et j’en passe ?
Et que dire de la situation en RDC, un pays que la Belgique avait colonisé il n’y a pas si longtemps ?
La Belgique est un petit pays, mais sa complexité est grande. Sa culture aussi. Et ses problèmes.
En résumé, le monde va mal. L’Europe va mal.
Mais le plus dangereux, c’est qu’elle ne le voit pas.
Voilà. Je suis restée assez vague et abstraite, mais j’espère que tu peux comprendre ce que je ressens à travers ces quelques mots que je voulais poétiques.
J’ai hâte d’avoir ton avis et de lire ta prochaine lettre.
Que penses-tu de la paix et de la justice en Europe ?
Penses-tu que ce continent est vraiment un exemple pour le monde ?
Et plus personnellement, que penses-tu de mon ressentiment envers la Belgique ainsi que ma « crise d’identité » ?
Laisse-moi conclure en te complimentant : tu as un don avec les mots.
C’est pour cela que je transmets mes salutations à ta très chère famille et que j’ai hâte de lire ta prochaine lettre.
Avec toute mon amitié, et à très vite !
Tessi
Lettre 3
Bukavu, le 13 avril 2025
Objet : Réflexions croisées autour de la paix, la justice et l’identité
Très chère Tessi,
Ta lettre m’a profondément touchée. En la lisant, j’ai ressenti un mélange d’émotions, de tristesse et de solidarité. Tu m’as permis de comprendre une réalité européenne que beaucoup de gens ignorent ou préfèrent ne pas voir : celle des discriminations que vivent les personnes issues de l’immigration, même nées et ayant grandi en Europe. J’ai réalisé que même dans un continent souvent perçu comme un modèle en matière de paix, de droits humains et d’inclusivité, il y subsiste des incohérences, des silences troublants et des injustices que beaucoup préfèrent ignorer.
Ton témoignage me rappelle une expérience personnelle très marquante. En septembre 2024, j’ai eu l’opportunité de participer à un échange interculturel à Anvers, organisé par l’équipe USOS. Pendant un mois, j’ai interagi avec la culture belge, marocaine, latino-américaine et tant d’autres cultures, et j’ai été confrontée aux contrastes culturels, aux stéréotypes, et à la complexité des identités. C’était la première fois que je découvrais la Belgique de l’intérieur, en interagissant à la fois avec la culture locale et les réalités migrantes. Ce séjour m’a permis de mieux comprendre les différences entre les régions de la Belgique : la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale. J’ai constaté de grands contrastes culturels, sociaux et économiques entre ces trois parties du pays. Aussi, lors de cet échange, j’ai vu de mes propres yeux comment certains stéréotypes persistent, notamment envers les personnes d’origine marocaine et turque, plus particulièrement à Anvers.
Nous avons aussi abordé des thèmes comme l’intégration des migrants dans l’éducation et le marché de l’emploi. C’est là que j’ai compris que beaucoup de personnes issues de l’immigration subissent des discriminations systématiques, malgré leurs diplômes ou leurs efforts. L’un des moments les plus marquants a été le témoignage d’une formatrice belgo-marocaine. Elle nous a confié qu’enlever son hijab lors des entretiens d’embauche augmentait ses chances d’obtenir un poste, parce qu’elle sait que ses chances seraient plus grandes sans cet élément visible de son identité, pour contourner les préjugés. C’était bouleversant de l’entendre dire qu’elle était née en Belgique, qu’elle avait grandi là-bas, qu’elle était citoyenne belge à part entière, et pourtant, son origine reste un obstacle dans le regard de certains. Son apparence suffit à éveiller la méfiance. Cette discrimination raciale, religieuse ou culturelle ne dit pas toujours son nom, mais elle est présente. Cette histoire m’a aussi permis de comprendre à quel point les stéréotypes peuvent peser lourd, et comment ils influencent l’accès à l’emploi, à l’éducation, et même à la justice. Tu m’as parlé de ta crise d’identité, et je peux te dire que je te comprends profondément. La Belgique est un pays complexe, Bruxelles n’est pas Anvers, la Flandre n’est pas la Wallonie, et même au sein des communautés, il y a des personnes formidables et d’autres moins ouvertes. Lors de mon séjour à Anvers, j’ai été témoin de belles âmes, belges, marocaines ou autres, qui luttent contre ces discriminations et qui croient en une société plus juste. Ce que tu vis est légitime, et il fallait beaucoup de courage pour l’exprimer comme tu l’as fait. Aussi, tu n’as peut-être pas vécu personnellement des injustices flagrantes, mais ta conscience est éveillée face au silence de la Belgique en particulier et de l’Europe en général devant certaines crises humanitaires comme celles en Palestine, au Yémen et dans les camps des Ouïghours. De plus, si la foi en Allah t’apporte paix et sérénité, alors je ne peux que m’en réjouir pour toi.
Tu m’as demandé mon avis sur la paix et la justice en Europe. Franchement, je pense que malgré ses limites, l’Europe est un continent qui offre un cadre plus stable, plus structuré, où les institutions fonctionnent correctement et où les droits humains sont globalement respectés. Les opportunités existent, surtout si l’on travaille dur, car tout est fondé sur le mérite. Ce qui est planifié par les gouvernements vise souvent l’intérêt général, ce qui n’est pas le cas chez moi, en République démocratique du Congo. Chez nous, la situation est beaucoup plus difficile. La paix est encore un rêve, la justice est sélective et souvent achetée, les inégalités sociales sont très profondes. Les jeunes sont parfois tentés de quitter le pays, non pas parce qu’ils n’aiment pas leur terre, mais parce qu’ils ne voient aucun avenir. Pourtant, je reste convaincue que nous avons un rôle à jouer pour changer les choses ici comme ailleurs. En tant que jeunes, nous devons refuser de reproduire les erreurs du passé. Nous devons lutter contre la corruption, œuvrer pour une société plus équitable, plus inclusive, où chaque citoyen, quelle que soit son origine et y compris les plus marginalisés, puisse s’épanouir. Voilà des combats que nous devons mener ensemble.
Tu sais, même en Belgique, malgré les efforts, il existe encore une injustice silencieuse. L’accès à la justice ou à l’emploi n’est toujours pas équitable pour les personnes d’origine étrangère, notamment les personnes noires. Les stéréotypes persistent, même envers les plus diplômés. Elle reste donc imparfaite, notamment dans son rapport aux minorités et à l’histoire. Comme toi, je m’interroge : comment l’Europe peut-elle brandir les valeurs de justice, de liberté et de paix, tout en restant silencieuse face à certaines souffrances dans le monde ? Pourquoi choisir les causes qu’on soutient et en ignorer d’autres ? Mais comme tu l’as dit, tout le monde n’est pas pareil. Il y a des personnes plus justes, ouvertes et bienveillantes. Et ce sont ces personnes-là qui redonnent de l’espoir. Ce que je retiens de tout ceci est qu’il y a possibilité de progresser, de réussir, et surtout d’exister, à condition de se battre, parfois plus que les autres. Je crois que le combat pour la paix et la justice est universel. Il ne se joue pas seulement dans les institutions, mais aussi dans nos attitudes, nos choix, notre manière d’interagir avec les autres.
Et c’est là que j’aimerais avoir ton avis : comment penses-tu que nous, les jeunes, pouvons faire concrètement, dans nos milieux respectifs, pour construire des sociétés plus justes, plus pacifiques et plus inclusives ? Comment pouvons-nous transformer nos blessures en force, et nos expériences en action concrète ? Quels gestes, quelles actions, quelles alliances devons-nous former pour bâtir l’avenir auquel nous aspirons ?
Je t’admire pour ton courage, ta lucidité et ta sincérité. Merci d’avoir partagé un pan aussi intime de toi. Merci d’avoir partagé avec tant d’authenticité ton vécu, ton questionnement identitaire et ton regard lucide sur l’Europe. Ton introspection sur ton identité est noble. Ce n’est pas une faiblesse mais une force : celle de toujours chercher à te comprendre pour mieux comprendre le monde autour de toi. J’ai hâte de lire ta prochaine lettre et de continuer ce dialogue si enrichissant. Je te transmets mes salutations les plus chaleureuses, ainsi qu’à ta famille.
Avec toute mon amitié, à bientôt !
Divine
Lettre 4
Bruxelles, le 3 mai 2025
Objet : La dernière lettre
Ma très chère Divine,
Voici notre dernière lettre sur la paix, la justice et les institutions efficaces. Ces lettres nous ont aidé à mieux nous comprendre mutuellement à travers ces thèmes essentiels, en plongeant dans l’histoire de l’une et de l’autre.
J’apprécie que tu m’aies partagé ton expérience à Anvers, et qu’en seulement un mois, tu aies pu apprendre tant de choses sur un pays petit mais complexe. Ta perspicacité m’enchante.
Après toutes ces anecdotes, tu m’as posé la question du “comment” : comment, en tant que jeunes, pouvons-nous contribuer au changement ? Contribuer à un avenir meilleur pour toutes et tous ? Je vais essayer d’y répondre du mieux que je peux.
Premièrement, je pense que nous, les jeunes, faisons déjà beaucoup sans même nous en rendre compte : nous exprimons notre identité unique à travers l’éducation, dans le monde du travail, dans la rue… En montrant que nous sommes capables, porteurs de valeurs et de principes… Et de cette manière, nous découvrons non seulement nos racines mais aussi celles du pays où nous avons grandi. Nous gardons l’esprit ouvert, parce que nous n’avons pas d’autre choix dans un monde aussi riche en diversité mais aussi de haine et de guerre.
Nous sommes obligés de nous expliquer pour des choses qui nous semblent logiques : le port du voile, le volume de nos cheveux, notre style vestimentaire et notre régime alimentaire… Tout cela nous oblige à rester droits dans nos bottes, à ne pas faire les choses en mode automatique. Le monde extérieur nous montre que nous sommes différents, oui, mais cela nous pousse à comprendre pourquoi et à forger des opinions plus solides.
En d’autres mots, nous changeons déjà le monde, pour le meilleur et parfois pour le pire. Oui, nous avons plus de pouvoir que nous ne l’imaginons. Nous pouvons donc dire que ce n’est pas si compliqué de rendre une société plus juste, pacifique et inclusive. Il suffit de faire de son mieux, d’être la meilleure version de soi-même, et le reste suivra.
En ce qui concerne nos blessures vécues, personne ne pourra jamais nous les enlever. La discrimination, nous la connaissons, nous l’avons goûtée, nous l’avons observée sous toutes ses formes : du regard condescendant aux commentaires vulgaires, d’un salaire plus bas au manque de crédibilité. Cette discrimination, nous la subissons parce que nous avons une autre couleur de peau, une autre origine, une autre langue, une autre religion…
Malgré ce que nous pensons, nos blessures nous rendent plus forts chaque jour, mais aussi plus vulnérables. Et sache-le : la vulnérabilité est une force – une force pour mieux comprendre l’autre, pour faire preuve d’empathie et s’accepter tel(le) que l’on est. Oui, on ne peut rien y faire à cette injustice, oui, on subit l’interdiction du voile dans certaines écoles, un travail forcé pour très peu d’argent en retour. Oui, on subit. Mais on ne subit pas sans répercussions.
Nous changeons le monde, et nous apprenons de nos blessures.
Mais alors, comment transformer toutes ces blessures en actions concrètes? En les assumant. Oui, en les assumant. Comment peut-on résoudre un problème si l’on ne reconnaît même pas qu’il existe ? Combattre l’injustice, c’est la regarder droit dans les yeux. “Oh, il m’a fait une remarque sexiste.” “Oh, elle me traite mal, elle ne me respecte pas.” La première étape, c’est de savoir.
Tout ça, c’est un travail individuel. Mais qu’en est-il du travail collectif ? Je vais être honnête : je ne sais pas quelle alliance il faudrait créer pour parvenir à un vrai changement, mais je sais qu’il faut arrêter de nous diviser et commencer à nous voir comme un tout. Un monde uni, qui veut le meilleur pour ses citoyens. C’est aussi simple que ça.
Comme le dit un hadith en islam : « Les musulmans sont comme un seul homme. S’il souffre de son œil, alors c’est tout son corps qui souffre ; et s’il souffre de la tête, alors c’est tout son corps qui souffre ». C’est cette façon de penser que nous devons adopter.
Pour résumer toutes ces pensées en quelques mots, je dirais simplement : pour changer les choses en tant que jeunes, soyons la meilleure version de nous-mêmes, et apprenons à penser de manière plus collective. Soyons comme un seul corps, qui travaille ensemble pour le faire vivre et respirer pleinement.
J’espère que tu apprécieras mes mots. Tu m’as dit que tu m’admirais pour mon courage, ma lucidité et ma sincérité. Pour ma part, je t’admire pour ta compréhension, ton intelligence et ton aspiration à un meilleur monde.
Ta compréhension, je la ressens à travers ton compliment sur mon introspection identitaire. Tu y vois une force, alors que je l’ai toujours perçue comme une honte, un poids, un problème. Merci de m’aider à voir les choses sous un nouvel angle. Un meilleur angle.
Ton intelligence, je la ressens à travers tes mots, ton histoire et tes questions. On ne s’est peut-être jamais vues, mais je te connais plus que des personnes que j’ai côtoyées maintes fois.
Et enfin, je t’admire pour ton aspiration à un meilleur monde. C’est pour ça que nous nous sommes toutes les deux inscrites à ce projet magnifique qu’est Global Pen Friends, n’est-ce pas ?
Quelles belles lettres nous avons écrites ! Sois-en fière ! Nos lettres sont seulement au nombre de quatre, mais elles abordent tellement de facettes du 16e Objectif de Développement Durable. En effet, nous avons parlé des inégalités en RDC et en Belgique, de l’injustice qui en découle, et nos anecdotes personnelles sont venues renforcer nos propos respectifs.
Je te remercie pour cette expérience si enrichissante et je te souhaite une belle continuation dans tout ce que tu entreprends.
Salutations à toi et à ta famille, et à très bientôt, si Dieu le veut.
Avec toute mon amitié, et à très vite!
Tessi